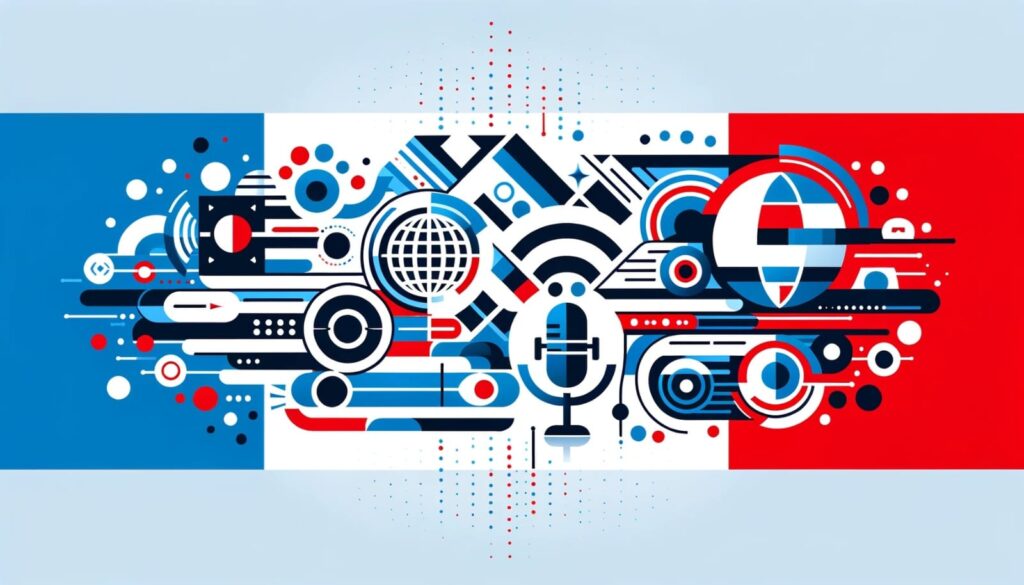
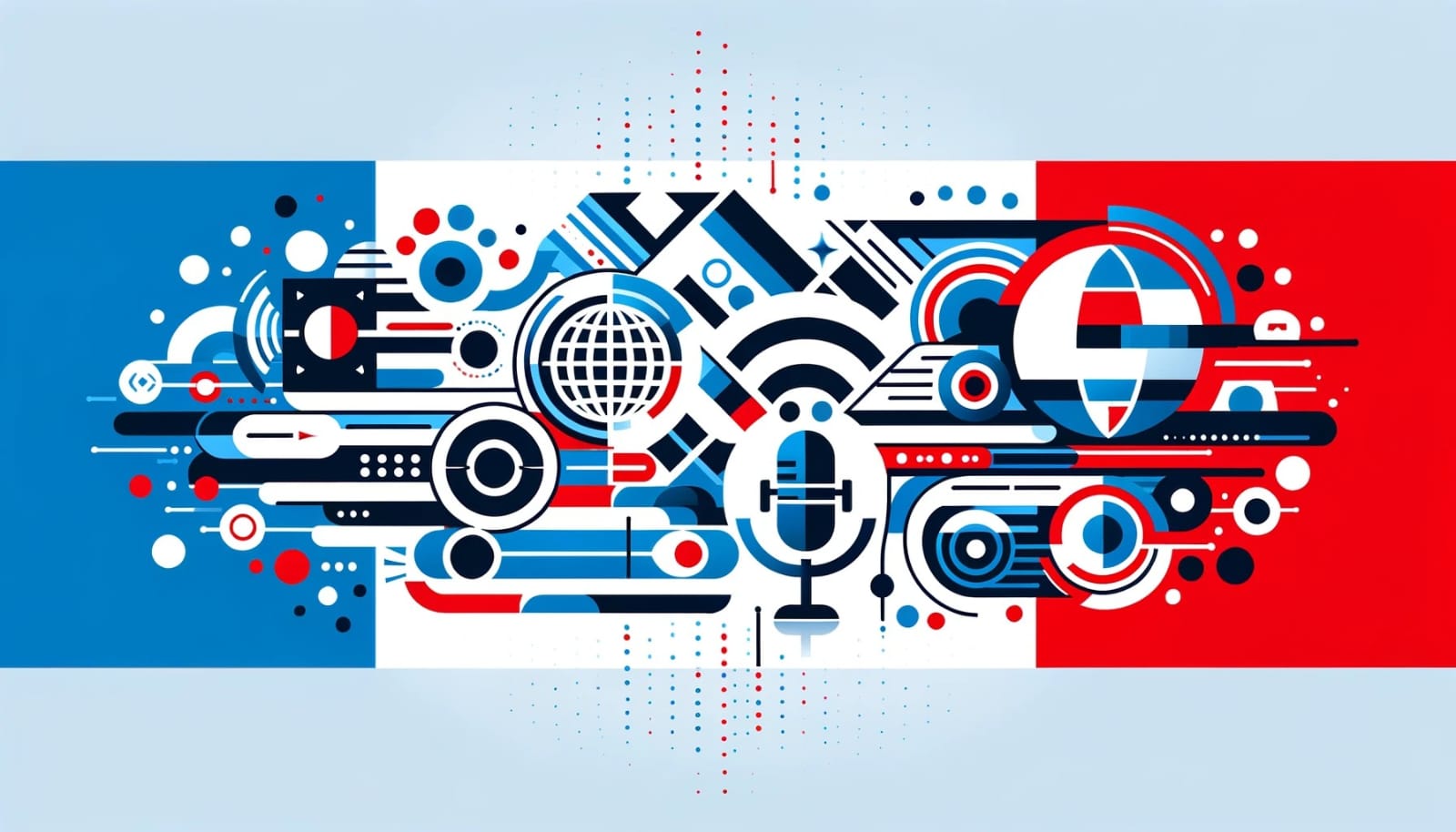
A l’invitation de l’Etat algérien, Mary Lawlor, rapporteuse spéciale des Nations unies (ONU) sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, vient de passer dix jours en Algérie. Une première. L’Irlandaise s’est rendue à Alger, à Oran et à Tizi Ouzou, entre le 25 novembre et le 5 décembre, pour rencontrer une cinquantaine de militants, des journalistes et des officiels « afin d’évaluer la situation » sur place. « Aucun pays du Moyen-Orient ou d’Afrique du Nord ne m’avait invitée à effectuer une visite officielle, explique-t-elle au Monde. C’est donc un signe de bonne foi et c’est encourageant car mon mandat est très controversé. »
Ainsi, en Algérie, Mme Lawlor dit avoir été d’abord « frappée par le fait que de très nombreuses personnes travaillant sur les questions des droits humains pouvaient opérer librement ». Toutefois, celles qui travaillent sur des sujets « sensibles » tels que la corruption, la migration, le droit du travail ou l’environnement et qui sont perçues du coup comme « critiques » du gouvernement sont confrontées à de « graves difficultés ».
Les militants rencontrés ont expliqué à l’envoyée de l’ONU qu’ils « sont soumis à une forme d’ingérence de l’Etat dans leurs activités pacifiques », « à une surveillance [policière] de routine » et à un « harcèlement » judiciaire. Lors de son déplacement en Kabylie, elle a pu d’ailleurs constater que certains d’entre eux ont été empêchés de se rendre à Tizi Ouzou. De plus, ils lui ont fait part de « la peur » qu’ils ressentent pour eux-mêmes et leurs familles quand ils exercent leurs activités. « Je vois donc un décalage entre ce que dit le gouvernement quand il assure qu’il va se conformer aux normes internationales et les lois faites pour limiter et sanctionner leur travail », souligne Mary Lawlor.
Etouffer l’action des défenseurs
La diplomate fait référence à l’article 87bis du Code pénal – amendé en juin 2021 – qui assimile à du « terrorisme » ou à du « sabotage » tout appel à « changer le système de gouvernance par des moyens non conventionnels », une définition « si large et si vague qu’elle laisse aux services de sécurité une grande marge de manœuvre pour arrêter les défenseurs des droits humains ». Ces derniers ont été nombreux à être poursuivis et condamnés sur cette base législative. Enfin, elle pointe d’autres délits utilisés pour étouffer l’action de ces militants comme l’« atteinte à l’unité nationale » ou encore l’« offense » envers le président de la République, les fonctionnaires, les institutions, le Parlement, les tribunaux, l’armée et le pouvoir judiciaire.
Il vous reste 55% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.
